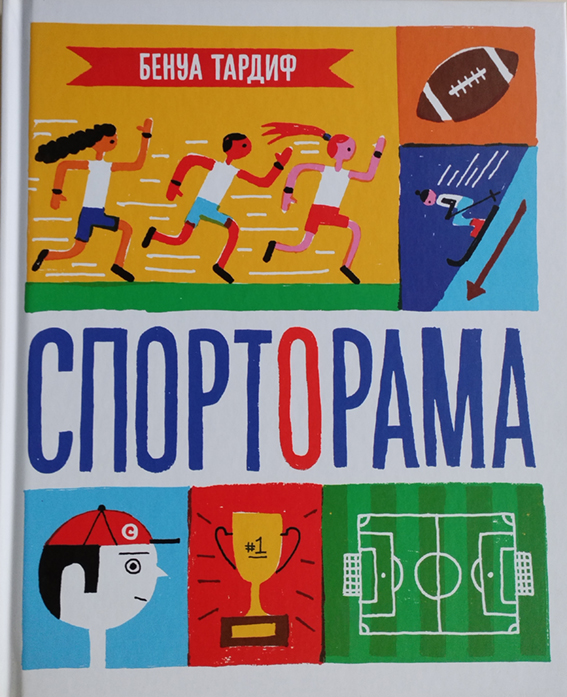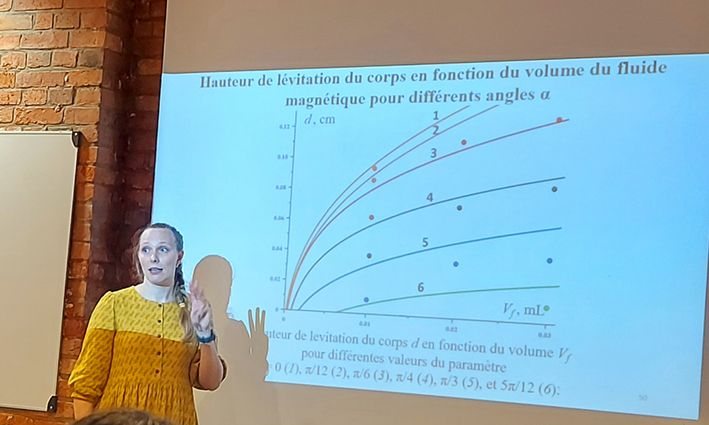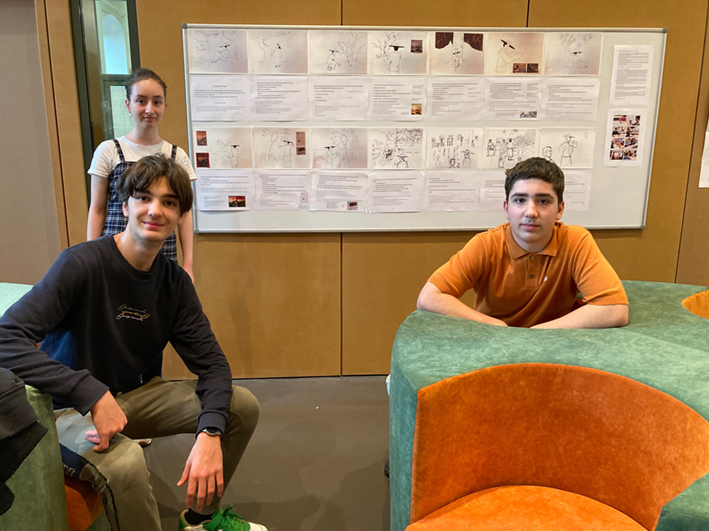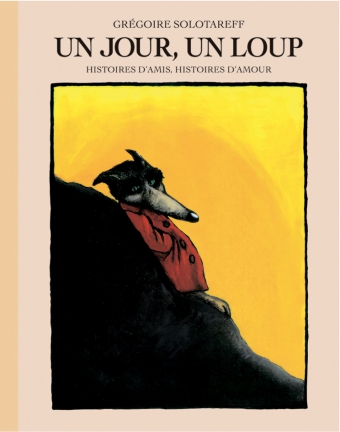Félicitations aux deux lauréates de cette première édition du concours de nouvelles !
Les membres du jury ont été sensibles à la richesse du vocabulaire, à la construction recherchée des phrases et à la qualité de la narration.

Toutes nos félicitations aux lauréates !
Hannah Rose, 3ème B
« Seule »
Quand le soleil disparaît derrière les milliers de gratte-ciel qui dominent l’horizon, je quitte ma demeure en direction du centre-ville. Je lance un dernier regard derrière moi, et je soupire. L’immeuble dans lequel je vis maintenant – identique à tous les autres bâtiments de la rue, du quartier, de la ville – me paraît tellement différent de la petite maison dans laquelle j’ai grandi, avec sa petite porte rouge, avec ses fenêtres qui étaient presque totalement cachées par le chêne dans le jardin, avec ses murs qui contenaient mes tout premiers souvenirs. Cette maison se trouvait dans ma ville, la ville où j’avais toujours vécu. En un clin d’œil, je m’y retrouve – dans cette ville mystérieuse, ma ville, avec ses centaines de ruelles qui serpentaient jusqu’à l’infini. Ma ville, avec ses secrets que nul autre que moi connaissait. Ma ville, ma cité, mon petit royaume à moi – qui aujourd’hui n’existe plus. Ma ville, dont la population a été complètement décimée ; ma ville, qui a été effacée des cartes ; ma ville, mon pays qui est déchiré par la guerre.
Et je me retrouve donc aujourd’hui dans cette nouvelle cité, étrange, hostile, me sentant complètement dépaysée. Rien ne m’est familier. Je ne connais personne. Je ne connais aucune rue, aucun bâtiment. Mais je ne peux vivre ainsi – il faut que je découvre ce qui m’entoure, il faut que je « fasse connaissance » avec cette ville qui devra désormais être la mienne.
Je respire profondément et m’arrache de mes souvenirs. Le ciel s’assombrit rapidement, il faut que je me dépêche. Je fais un premier pas devant moi, plongeant dans l’obscurité. Un deuxième pas, et les ténèbres m’engloutissent. En marchant, je choisi des rues au hasard, errant d’un boulevard identique à un autre. Les bâtiments, tous d’une couleur grisâtre, semblent toucher le ciel. J’essaie en vain de trouver de la verdure, mais il n’y a aucun arbre, aucune trace de la nature. Et lorsque l’odeur de l’essence, mélangée à celle des cigarettes et des égouts, parvient à mes narines, je m’étouffe. Je pense à mon petit jardin — mais on l’a probablement déjà réduit en cendres. Les larmes me montent aux yeux en pensant à la destruction de tout ce qui m’est cher, mais je suis rapidement distraite par un autre malheur qui s’ajoute à ma situation : il fait un froid épouvantable. Je me rends compte que je vais bientôt geler, et qu’il faudrait bien rentrer. Mais lorsque je regarde autour de moi pour m’orienter, je ne reconnais aucun bâtiment — cette rue ressemble aux milliers d’autres rues qui parcourent la cité. Je suis perdue, perdue au milieu d’une cité hostile que je ne connais point. J’essaie de saluer quelqu’un pour leur demander où je me trouve, mais tous m’ignorent. Mon souffle se condense dans l’air. Que vais-je faire ?
En regardant autour de moi, j’aperçois un groupe de gens qui semblent se diriger vers le centre-ville. Je décide de les suivre, en pensant que je pourrais peut-être retrouver mon chemin à partir de là-bas. En marchant, je m’aperçois que les rues deviennent de plus en plus larges. De plus en plus de gens nous rejoignent au fur et à mesure que l’on se rapproche du centre. Deux, trois, quatre, dix gens s’ajoutent au groupe. Je me retrouve bientôt au sein d’une foule grandissante. Au fur et à mesure, je dois adapter ma vitesse à celle des autres, il faut que je balance mes bras et mes hanches d’une certaine manière afin d’éviter de frôler les gens. On me gêne, on me pousse, on m’écrase ; il faut absolument échapper à cet entassement. J’augmente la vitesse à laquelle je marche afin de les dépasser, mais lorsque je les dépasse, je ne sais plus que faire, ni pourquoi je les ai dépassés, car je me retrouve dans exactement la même foule, avec exactement la même gêne.
Je reste figée pendant une seconde, et je regarde autour de moi. Je suis entourée de milles couleurs, milles bruits, milles odeurs. Mais je n’entends rien, sauf ma propre respiration et mon cœur qui semble battre tellement fort qu’il est étonnant que personne d’autre ne l’entende. Mais il faut que je continue — je ne peux malheureusement pas rester ainsi jusqu’à la fin des temps — et, avec une dernière inspiration, je plonge dans la foule.
Je regrette immédiatement ma décision.
Sans réfléchir, des milliers de gens courent autour de moi, se livrant à leurs occupations personnelles. Ils ressemblent à de petites fourmis — un groupe, un but, un cerveau, une mentalité. Chacun de mes mouvements est délibérément calculé. Je dois marcher comme eux, aussi rapidement qu’eux, je dois penser comme eux. Si je m’arrête, si je tombe, ils me contourneront, me dépasseront, me piétineront. Si je meurs, ils continueront. En regardant cette masse vivante, silencieuse et oppressive, indifférente à toutes mes luttes et à tous mes malheurs, je m’asphyxie. J’ai envie de me recroqueviller sur moi-même et d’oublier le monde, de tout oublier. Je veux me lever, partir, fuir, et ne jamais revenir. Mais impossible de m’en extraire.
Ma vision s’assombrit. Mon cœur bat à tout rompre. Je n’arrive plus à respirer. Je suffoque. Entourée de milliers de gens, je n’ai jamais été aussi seule.
Romane, 6ème B
« Le retour des mésanges bleues »
Avez-vous déjà vécu une injustice ? Avez-vous été dans le cœur de l’action ? L’avez-vous vécu sans même comprendre ce qui se passait autour ? Même si vous ne vous en souvenez pas, il reste des traces, elles réapparaitront. Avez-vous déjà été au beau milieu d’une foule parlant une langue que vous ne comprenez pas, certaines personnes s’affolant, d’autres se pansant, d’autres encore se barricadant… ?
Au milieu d’une poussette, insouciante, mais sentant quand même une ambiance pesante dans l’air, foulant d’un pas hésitant le sol recouvert de suie et de caoutchouc brulé, les restes des barricades de pneus et autres objets indéfinissables -je ne savais pas quoi dire, je n’avais rien à dire, je savais à peine parler. Pourtant, lors d’un rassemblement de masse sur la place principale, je laissai échapper mon premier “j’ai peur”. Les gens criaient pour refermer les portes de l’enfer. Ce rassemblement était le fruit d’une nuit tragique de novembre, où les démons s’étaient emparés de fusils, laissant dans des rues des spectacles macabres. Les fleurs du mal sortaient du sol même pour dévorer le peu d’espoir qu’il restait. Depuis cette nuit-là, un bourdonnement s’intensifiant à chaque instant, amenait les gens à se révolter. Ce bourdonnement s’était mué en un cri de détresse aigu, recouvrant les chants des mésanges bleues. La paix n’était plus, même les berceuses des oiseaux n’aidaient plus à s’endormir. Le soir, quand nous entendions des feux d’artifices, je prenais peur. J’avais raison, ils n’annonçaient pas l’accalmie du peuple. Je me souviens des paroles de ma mère, “A mes dix-sept ans, je fis un vœu, vivre une révolution. Le ciel m’a entendue, mais il m’a joué un tour ; on habite dedans, mais on est dehors.” En effet, nous ne savions rien de ce peuple, de leurs traditions, de leur histoire…Même si nous étions au cœur de l’action, nous étions dehors !
Quand décembre et janvier furent passés, février tomba dans un retentissement effroyable. L’inquiétude qu’avait éprouvée le peuple se confirma, personne ne voulait le croire. Heureusement, les gens nous acceptèrent, même avec joie. Avant, avant que tout cela n’éclate, les gens étaient rassurés qu’il y ait encore des étrangers, comme si cela voulait dire que tout n’était pas perdu. Dans la rue de notre logement, deux enfants se répétaient quelques phrases, comme une ritournelle :
Petit enfant, petit enfant,
Avez-vous pensé aux petits enfants ?
Lâchez-donc vos armes,
Soyez gentils avec les petits enfants.
Mes seuls souvenirs sont chétifs – une balade en poussette sur la place principale, entourée de barrières de sécurité en métal froid ; mes jeux avec mon voisin et nos collections d’éponges, collection que l’on affectionnait particulièrement ; l’arôme étranger de l’air ; et les chants des oiseaux, enfin revenus pour le printemps, quand l’agitation s’était calmée. Les arbres commençaient à donner naissance à de fins bourgeons, les mésanges bleues revenaient, et la paix s’installait.
Cette nouvelle est basée sur une histoire vraie, sur mon histoire, lors de ma petite enfance.






































 Nous avons eu la chance de monter à l’étage des bureaux pour nous plonger dans l’ambiance du travail de nombreux personnels du service éditorial et du service marketing qui créent des livres et qui assurent la liaison avec les auteurs, les illustrateurs, les traducteurs, les correcteurs ainsi que le graphiste-maquettiste sans parler des services communication et diffusion qui sont très importants pour la vente des livres. Madame Elena Titova qui a animé cette rencontre nous a présenté les différentes étapes nécessaires à la fabrication d’un livre. Nous avons également visité la librairie très cosy de cette maison d’édition qui se trouve au rez-de-chaussée.
Nous avons eu la chance de monter à l’étage des bureaux pour nous plonger dans l’ambiance du travail de nombreux personnels du service éditorial et du service marketing qui créent des livres et qui assurent la liaison avec les auteurs, les illustrateurs, les traducteurs, les correcteurs ainsi que le graphiste-maquettiste sans parler des services communication et diffusion qui sont très importants pour la vente des livres. Madame Elena Titova qui a animé cette rencontre nous a présenté les différentes étapes nécessaires à la fabrication d’un livre. Nous avons également visité la librairie très cosy de cette maison d’édition qui se trouve au rez-de-chaussée.